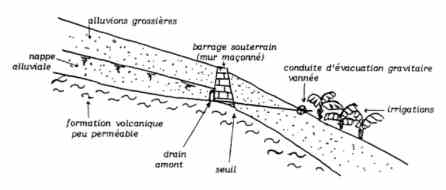
Débit d’écoulement

Je viens de lire dans le dernier numéro d’H20 du 15 juin 2000,
l’intéressant article de Brice Wong sur le barrage souterrain qui
fait le point des principes techniques de ce procédé. Cet
article, sur un sujet qui revient périodiquement à la surface
de l’actualité du développement rural, me conduit à
apporter quelques précisions et surtout quelques importantes réserves
qui peuvent s’exprimer comme suit :
Le débit de la nappe que peut arrêter un barrage
souterrain est généralement très faible et par conséquent
peut se trouver hors de proportion avec le coût de l’ouvrage nécessaire.
Cette remarque liminaire doit inciter les concepteurs à une prudente
et sévère analyse hydrogéologico-économique
préalablement à toute construction.
Principe
Comme un barrage sur une rivière arrête un écoulement
superficiel, en un site étroit choisi avec soin, le principe d’un
barrage souterrain consiste à arrêter l’écoulement
souterrain d’une nappe « d’oued », (qu’on appelle parfois aussi
« inféroflux », ou encore « sous-écoulement
»), par imperméabilisation verticale, en un site choisi pour
son étroitesse, dans le même souci de limiter largeur et coût.
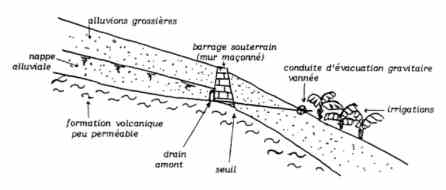
Débit d’écoulement
De même qu’avant de réaliser un barrage superficiel on
doit calculer les apports des crues capables de le remplir, le débit
de l’écoulement souterrain « à arrêter »
doit impérativement être calculé avant tout projet
de barrage souterrain, ce qui se fait en appliquant la Loi de DARCY :
Q = K * h *L *i.
L’application de cette loi impose de connaître, donc de mesurer
d’abord in situ :
K : la perméabilité (ce qui demande des essais de pompage
sur puits ou forage)
h : la hauteur aquifère, et L : la largeur d’écoulement,
(ce qui requiert des sondages)
i : la pente de la nappe, souvent proche de celle du terrain (ce qui
demande un peu de topographie entre deux puits ou deux sondages assez distants).
Importance de la pente
Il faut , ici, attirer l’attention sur le fait que le facteur i, pente
de l’aquifère, bien que sans dimension, est généralement
de l’ordre du pour mille, ce qui conduit le plus souvent à des débits
souterrains très faibles, comme le montrera l’exemple ci après.
Il est à ce propos particulièrement nécessaire
de mettre en garde contre un ouvrage publié en 1978, sous
le titre « les barrages souterrains » (Editions du «
Ministère de la Coopération ») qui est porteur d’une
erreur fondamentale puisqu’il omet malencontreusement le gradient
dans le calcul du débit du flux souterrain à arrêter.
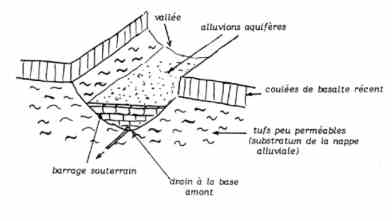
Exemple
L’exemple qui suit est certainement, en ordre de grandeur, représentatif de bien des cas concrets dans le Sahel et permet d’appuyer ce propos et de conclure.
Imaginons un bel « oued », de largeur L = 50 mètres
rempli, sur un substratum imperméable, d’alluvions sableuses fines
mais propres, présentant une valeur de perméabilité
assez courante K = 10-4 m/s, épaisses au total de 5 mètres
dont 3 mètres (h) sont mouillées, avec une pente, déjà
appréciable, de 2 pour mille. Le débit souterrain, aisé
à calculer, s’élève à :
Q = K . h . L . i = 10-4 * 3 * 50 * 2 * 10-3 = 3 *10-5 m3/sec
= 2,6 m3/jour
Un tel débit peut, très certainement, être capté par un simple puits busé et gravillonné de 5 mètres de profondeur qui pourra de plus exploiter les réserves de la nappe alluviale à bien meilleur compte qu’un barrage souterrain de 50 x 5 m = 250 m2. Pour celui-ci je laisse les intéressés apprécier le coût, chacun selon ses propres conditions locales de matériaux, de procédures et de mise en oeuvre.
Assurément, il n’est pas inimaginable (en zone de piedmont) de
rencontrer des conditions plus favorables : une pente de 1% (par exemple)
et une granulométrie plus grossière (K =10-3 m/s : sable
propre grossier) multiplieraient par 50 le débit de l’exemple ci
dessus, le portant à 130 m3/jour. Ces conditions, rares, changeraient
complètement la donne, et cela peut permettre de conclure ainsi
brièvement :
le barrage souterrain paraît devoir être réservé
aux zones de piedmont.
Je reste à disposition pour en discuter, examiner sur pièces
des exemples ou projets, et conclurai en signalant que nous avons publié,
voici quelques années déjà avec J.C. Andreini, à
la demande du CEFIGRE, (Centre d’Etudes et de Formation Internationale
à la Gestion des Ressources en Eau, à SOFIA ANTIPOLIS) un
article détaillé sur le sujet que j’ai adressé à
Brice Wong et qui peut être fourni sur demande.
Retraité de BURGEAP qui a consacré une part importante
de sa carrière à l’hydrogéologie,
et à l’hydraulique villageoise en zone sahélienne.
e.mail: lucien.bourguet @wanadoo.fr