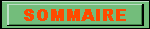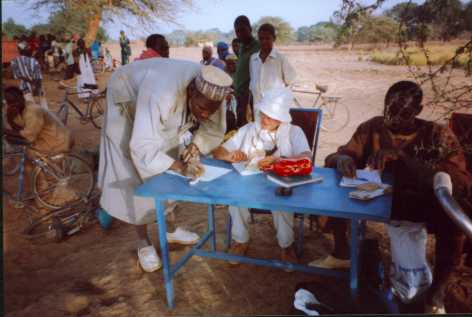Digue de Coalla Nebba : Y’a pas de problème
| HSF, Via Nebba et Tinyenga Niyemba ont effectué
une mission à Coalla (Burkina Faso) en février et mars 2000
pour réaliser avec la population locale une digue en terre. Les
problèmes techniques ayant été largement évoqués
dans l’article paru dans le numéro précédent d’H2O,
Nathalie et Julianne se contentent ici de quelques réflexions sur
ce qu’elles ont directement perçu durant ces sept semaines de travail
en pays gourmanché. |
La vie communautaire
Les activités villageoises sont gérées par des
groupements villageois d’hommes, de femmes et parfois mixtes. Ces groupements
se réunissent régulièrement pour discuter de thèmes
divers et variés qui peuvent concerner la santé, l’hygiène,
l’alphabétisation des adultes, le prix du sac de mil, etc. Ces débats
conduisent aux actions à mettre en place pour le développement
du village.
Ces groupements villageois ont souvent été initiés
et financés par diverses ONG pour pallier le manque d’initiative,
d’organisation et de moyens des structures administratives en place.
Au niveau du village, il existe aussi des comités de gestion
qui conseillent les groupements villageois et qui prêtent de l’argent
à des taux préférentiels.
Ayant besoin de croire en des jours meilleurs, les burkinabés
sont très religieux. Ils sont, dans l’ordre d’importance, musulmans,
animistes, chrétiens (catholiques et protestants).
Toutes ces communautés vivent en parfaite entente : dès
qu’une fête religieuse est célébrée, tous les
villageois y participent quelle que soit leur appartenance.
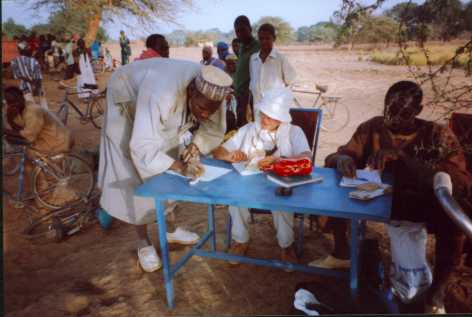
Du travail des hommes…
L’activité économique en pays gourmanché est liée
aux saisons. Pendant la saison pluvieuse, de juin à septembre, les
hommes se consacrent à la culture du petit mil, du sorgho blanc,
des arachides, du sésame, du pois de terre et parfois des haricots.
Les récoltes se font d’octobre à décembre.
Passée cette période d’intense activité, ils s’occupent
en élevant un bœuf et/ou 3 à 4 moutons qu’ils vendent en
général au mois de mai. Certains d’entre eux espèrent
faire fortune en s’improvisant chercheurs d’or dans les collines voisines,
d’autres font du commerce de marchandises diverses (bonbons, savon, sucre,
allumettes, cigarettes, pastis, bière, etc.). Les plus audacieux
sont cordonnier, teinturier, meunier, pharmacien, les plus courageux partent
chercher du travail dans les plantations en Côte d’Ivoire ou se rendent
dans les zones voisines où la présence de barrages leur permet
de pêcher et de vendre le poisson. Les mieux nantis attendent passivement
la prochaine saison pluvieuse.
… et de celui des femmes
Les femmes, tout comme les hommes, se consacrent aux cultures pendant la
saison pluvieuse. Elles ont en plus à piler le mil - on peut entendre
les pilons à partir de 5 heures du matin et jusqu’à 22 heures
- à assumer les corvées de puisage d’eau et à s’occuper
de la préparation de la nourriture (le tô servi à tous
les repas avec des variantes dans la sauce). Ces activités se poursuivent
aussi à la saison sèche. Pendant cette période, et
en plus des tâches domestiques, elles doivent se débrouiller
pour avoir l’argent nécessaire à l’achat de nourriture. Certaines
font donc du commerce de marchandises diverses, mais aussi de nourriture
qu’elles ont préparée (galettes de mil, biscuits d’arachide,
beignets de haricot, etc.), d’autres sont couturières, potières,
coiffeuses etc.
Toutes ces activités sont faites avec le petit dernier accroché
dans le dos et avec un œil sur les jeunes enfants non scolarisés.
Les femmes ont évidemment la charge des enfants bien que ceux-ci
appartiennent à l’homme. Notons cependant que les vieux1 acceptent
bien volontiers de surveiller les enfants lorsque c’est nécessaire.
Dans la majorité des cas, les hommes sont opposés à
l’activité salariée de leurs épouses. Cet état
de fait est logique puisque les femmes sont soumises à l’autorité
de leur époux. Sauf si elles apportent plus d’argent qu’eux au foyer
conjugal…

L’éducation des enfants
L’enfant burkinabé n’est pas, comme en Europe, l’objet de toute
l’attention de ses parents. Il est encore souvent considéré
comme une bouche à nourrir, bien que son statut soit en train d’évoluer
de manière positive.
Traditionnellement, l’enfant aîné est donné en
signe de reconnaissance et de respect à son oncle ou à sa
tante. Ses parents naturels n’ont aucun droit sur lui et ne peuvent pas
décider de son appartenance religieuse ou de sa scolarité.
Cette tradition encore très présente chez les gourmanchés
tendrait à disparaître.
Dès qu’ils quittent le dos de leur mère, les enfants
acquièrent une grande autonomie. Ils sont élevés en
toute liberté, sans contrainte d’horaire. Ils mangent quand ils
ont faim, dorment quand ils sont fatigués là où ils
se trouvent et dans n’importe quelle position (couchés, assis et
même debout !)
Ce manque de repères et de règles rend très difficile
leur scolarisation et oblige les enseignants à mener une discipline
très autoritaire.
Le taux de scolarisation en primaire est de l’ordre de 40 %. Les garçons
sont toujours plus scolarisés bien qu’un effort de sensibilisation
à la scolarisation des filles soit fait au niveau national. Les
classes comptent au moins une trentaine d’élèves et peuvent
atteindre facilement 60 élèves et plus. Ceci est principalement
lié au manque d’instituteurs dans le pays mais aussi au manque de
volontaires pour enseigner en brousse.
Moins de 10 % des enfants poursuivent un cycle secondaire bien que
la moitié d’entre eux réussissent à obtenir leur certificat
d’étude. Le cycle supérieur ne concerne qu’une infime partie
de la population urbaine (1 à 2 %).
Les jeunes déplorent également le manque d’enseignement
technique.
Encore faible, le taux de scolarisation progresse pourtant chaque année
grâce à la prise de conscience des jeunes parents de l’intérêt
de l’accès au savoir. Ils ne se contentent plus de scolariser leur
aîné, qui habituellement devenait fonctionnaire et pourvoyait
aux besoins de la famille, mais ils scolarisent aussi les suivants pour
qu’ils puissent prétendre à une vie meilleure que la leur
et qu’ils contribuent au développement de leur village et de leur
pays.

Et sur le chantier, c’était
comment ?
Faire travailler les chefs d’équipe relevait du défi.
Traditionnellement, les chefs ne travaillent pas, puisqu’ils sont chefs
(Ah ! tendre souvenir de l’époque coloniale…). Comme ils étaient
payés le double des travailleurs, nous ne pouvions accepter de les
laisser jouer au petit chef colonial. Nous leur avons donc gentiment fait
comprendre que le chef se devait de montrer l’exemple parce qu’il savait
exactement ce qu’il fallait faire pour que le travail soit correctement
réalisé. Nous leur avons également expliqué
systématiquement ce qu’ils faisaient et pourquoi ils le faisaient.
Certains nous justifiaient la lenteur de leur compréhension par
leur couleur de peau “ nous les noirs, on comprend pas bien ”. Ils ont
pourtant parfaitement compris.
Raisonnables, nous ne leur avons pas proposé de faire des équipes
mixtes. Les hommes travaillaient dans les zones d’emprunts et les femmes
compactaient en chantant ou en poussant leur youyou. Pourtant, un jour,
il a fallu renforcer les équipes de femmes au compactage… Comment
réussir à persuader un homme de faire le même travail
qu’une femme sans heurter sa susceptibilité et sa fierté
masculine ? Il a suffi de leur expliquer que le noyau était la partie
la plus importante du barrage pour qu’ils se sentent honorés de
participer au compactage. Et c’est dans une ambiance rythmée de
chants et de coups de bâtons (sur le noyau) qu’hommes et femmes gourmanchés
ont travaillé ensemble à la même tâche !
L’important est qu’ils maîtrisent maintenant les techniques du
barrage en terre (compactage, filtre, déversoir, etc) et que certains
d’entre eux se sont même familiarisés avec les termes techniques.
À tel point qu’ils ont créé une association, Hamtandi
«l’amitié prolongée», présidée
par Aremo Mousbaou (propriétaire du camion), pour construire des
barrages dans tout le pays durant la saison sèche !
La présence de membres de l’association Via Nebba sur le chantier
a également été fort appréciée par les
villageois qui s’en trouvaient plus motivés, ainsi que par Julianne
et Nathalie qui en ont retiré un grand soutien moral et des contacts
humains très enrichissants.
Mais le fait le plus marquant est la façon dont a évolué
la perception du barrage par les villageois. Ils ne voyaient au départ
qu’un moyen de désenclaver Coalla et la future route qu’ils pourraient
emprunter en saison pluvieuse. Puis, au fur et à mesure de l’avancée
des travaux, ils se sont mis à parler des poissons qu’ils pourront
à nouveau pêcher, des cultures de décrues qu’ils pourront
pratiquer et de toutes les terres irriguées qu’ils pourront cultiver.
Ils ont réussi à se projeter dans l’avenir, concept pour
eux difficile puisqu’ils ont une vision cyclique du temps.
Grâce à ce changement d’état d’esprit, ils ont
même accepté de travailler gratuitement la dernière
semaine de présence de HSF. 210 personnes sur 280 se sont présentées
alors que nous n’en attendions au mieux qu’une centaine…
En effet, comme le rythme des travailleurs était plutôt
lent par rapport à nos prévisions, la digue n’a pu être
achevée malgré le prolongement du séjour de Nathalie
d’une semaine supplémentaire. Cette lenteur, accrue par la fatigue
croissante des ouvriers, par des intempéries, par la fête
du Tabaski2, et malheureusement par des décès, était
bien sûr liée à la méconnaissance du maniement
des outils mais aussi (surtout ?) à leur incapacité de travailler
tout en discutant. Comme ils parlent beaucoup…
L’association Hamtandi a donc pris le relais. L’achèvement de
la digue de Coalla sans la présence de HSF sera sa première
réalisation.
Par l’implication de tous les villageois, de leurs chefs, du préfet,
de Via Nebba, de Tinyenga Niyemba et de HSF, dans une ambiance fraternelle
et d’échanges intellectuels et culturels, l’achèvement de
la digue devrait être assuré avant la saison pluvieuse et
elle résistera aux crues… Les batteurs de sable l’ont prédit…