

La finalité de notre mission était de mettre au point
un projet pour l’alimentation en eau potable des populations rurales, particulièrement
défavorisées à ce niveau. Nous avons donc mené
une enquête pour d’une part comprendre les besoins de la population,
et d’autre part, établir un état des lieux en matière
d’alimentation en eau (nature des prélèvements existants,
état des installations, intérêt de valoriser davantage
les ressources exploitées ou d’en prospecter d’autres).
Déroulement de la mission
Notre première journée sur place est consacrée
aux rencontres avec les autorités locales à Pietersburg où
nous prenons connaissance de la situation générale de la
province.
Les jours suivants, depuis notre pied à terre à Pietersburg,
nous nous rendons sur le terrain, accompagnés de William Madosela
et d'Andreas Mamabolo du gouvernement local. Ils organisent le planning
des réunions et sont nos interprètes auprès des villageois.
Sur place, après avoir pris connaissance des problèmes auprès
des comités d’eau et des chefs de villages, nous visitons quelques
installations. Nous avons visité au total quinze municipalités
(groupement de plusieurs dizaines de villages). Celle de Greater Mankweng
reflète bien la situation.

Situation générale :
La province du nord (6,5 millions d’habitants) est une des plus pauvres
d’Afrique du Sud. Administrée par Pietersburg, elle est constituée
essentiellement de zones rurales où vit 86% de la population. La
plupart de ces zones rurales sont d’anciens « Bantoustans »
ou « Homelands », zones d’habitats réservées
aux noirs, créées à l’époque de l’Apartheid.
Dans les villages, caractérisés par un habitat très
dispersé, les infrastructures sont encore très peu développées
et l’alimentation en eau potable des communautés est un problème
majeur. L’exploitation de l’eau souterraine, qui constituait jusqu’à
présent l’unique source d’eau potable pour la population rurale
est actuellement mise en défaut par la vétusté des
installations et la croissance démographique.
D’importants travaux, consistant à acheminer l’eau depuis des
barrages, des prises en rivière ou des nappes phréatiques
suffisamment productives sont en cours de réalisation dans plusieurs
districts de la province. Cependant, le raccordement des villages les plus
isolés à ces grands schémas d’adduction d’eau n’est
envisageable qu’à long terme. D’autre part, l’éloignement
de cette nouvelle ressource par rapport aux agglomérations et la
dispersion de l’habitat en zone rurale rend ces projets très coûteux
et beaucoup d’entre eux sont actuellement interrompus faute de crédits
suffisants pour terminer les travaux.

Visite de la municipalité de Greater Mankweng
Comme partout en zone rurale, la seule ressource a toujours été
l’eau souterraine. Le village où nous avons rendez-vous utilise
actuellement deux puits situés dans un aquifère productif
mais dont l’équipement est sous-dimensionné. L’un, situé
à 4 km du village est seulement équipé d’une pompe
à main. L’autre est muni d’une pompe diesel mais ne fonctionne en
moyenne qu'une fois par semaine car l’argent pour acheter le carburant
fait défaut. D’autre part, lorsque ce pompage est en marche, il
ne permet pas de remplir le réservoir. En effet, la conduite qui
sert à le remplir est aussi celle qui distribue l’eau aux habitants.
Le jour où la pompe fonctionne, tous les robinets branchés
sur cette conduite sont ouverts et la pression n’est plus suffisante pour
que l’eau puisse arriver au réservoir et aux habitants situés
les plus en hauteur.
L’infrastructure actuelle ne peut pas subvenir à la totalité
des besoins de la population et un apport d’eau supplémentaire est
nécessaire. D’autre part, comme souvent en zone rurale, aucun mode
de facturation pour l’eau n’a jamais été mis en place. C’est
donc le gouvernement qui subventionne complètement le système
mais cet argent ne permet pour l’instant que de payer l’eau achetée
à l’extérieur, son transport, et le diesel pour la pompe.
Pour nous montrer un cas concret illustrant bien les problèmes,
les villageois nous emmènent voir les femmes faire la lessive.
Elles puisent l’eau au seau, dans un trou creusé dans le
sable à environ un mètre de profondeur. Même si cette
nappe est actuellement sous-exploitée, nous remarquons que
c’est la fin de la saison sèche mais que l’eau reste abondante.
Pourtant, à environ 100m de ce puits artisanal, deux forages attendent
toujours d’être équipés d’un système de pompage.
Nous avons très souvent rencontré cette situation. La
ressource en eau existe, mais ce sont les moyens pour l’exploiter correctement
et les compétences locales pour entretenir les installations qui
manquent.
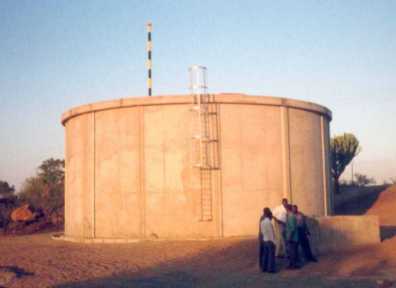
ANNEXE : La situation actuelle des zones rurales
découle de la politique de l’Apartheid :
La loi sur l’habitat séparé
(1950) stipulait que des millions de noirs, représentant environ
les trois quarts de la population, devaient obligatoirement vivre sur seulement
7,5% du territoire. En 1959, ces zones furent baptisées «
bantoustans ». En dehors de ces domaines réservés,
qui étaient invivables et surpeuplés, il leur était
interdit d’acheter, de louer ou même de devenir métayers.
Ils furent donc forcés d’abandonner le travail de la terre et d’aller
travailler comme ouvriers sous-payés là où les blancs
avaient besoin de main-d’œuvre : dans les mines et les grandes exploitations
agricoles. Des déplacements incessants entre les zones de travail
et les bantoustans étaient donc nécessaires. Les noirs étaient
soumis à un régime de passeport qu’ils devaient pouvoir montrer
à tout moment. Après des années de lutte, l’ANC remporta
les élections en 1994 et un long processus de restitution commença
pour permettre enfin aux populations expropriées d’avoir accès
à la propriété. Malheureusement, l’abolition de l’Apartheid
n’effaça pas d’un trait des années d’exploitation et, les
zones rurales, particulièrement pauvres, sont toujours le siège
d’une forte migration de la main d’œuvre masculine. Les seules activités
qui y subsistent sont l’élevage très extensif et quelques
cultures soumises au régime de sécheresse.