

Ces deux titres, parmi probablement bien d’autres, nous interpellent
directement et semblent remettre en cause nos plus profondes convictions
de techniciens de l’Hydraulique. Des années durant (de notre vie
professionnelle à notre action d’aujourd’hui à HSF) nous
n’avons cessé de nous battre pour que l’Eau, cette richesse indispensable
à la survie même de l’Humanité, soit mise à
la disposition de tous. Les barrages petits et grands étaient, pour
nous, les moyens indispensables pour mettre en réserve un bien très
précieux et pour maîtriser les crues des fleuves ou rivières
qui de la France au sud-est de l’Asie, récemment encore, ont ravagé
maintes contrées en faisant de nombreuses victimes.
C’est pourquoi les critiques de ces articles de journaux, même
disparates et parfois contradictoires, ne peuvent nous laisser indifférents.
Ils méritent lecture et analyse approfondies, pour nous permettre
de relancer un débat que nous avons amorcé à plusieurs
reprises dans notre journal H2O et qui restera toujours d’actualité.
Notre propre expérience en France :
Ceux d’entre nous qui ont eu la chance de vivre «l’époque
des grands barrages de la France d’après-guerre» : Tignes,
Serre-Ponçon, Roselend, Le Mont-Cenis, Vouglans, Sainte- Croix…etc,
auraient tendance à classer, sans modestie, ces ouvrages parmi
«les plus grands chefs-d’œuvre créés de main d’homme»,
dont l’utilité sociale et économique n’est plus à
démontrer, tout en produisant une énergie indéfiniment
renouvelable et non polluante. Cependant, on ne peut oublier qu’à
part Tignes, dont les villageois se sont sentis «sacrifiés»
à l’intérêt national, les autres grands barrages français
ont bénéficié de conditions écologiques et
humaines particulièrement favorables.
Aussi, nous n’arrivons guère à comprendre la «mobilisation
de quelques écolos» contre les projets du Clou ou de la Haute
Romanche, dont les impacts sur l’environnement ont été soigneusement
étudiés, et les effets négatifs très marginaux
pratiquement supprimés.
De même, le barrage de Villerest est accusé de tous les
maux de pollution, alors qu’il ne fait qu’emmagasiner les nombreux détritus
déversés sans vergogne par les riverains depuis l’amont (lisiers
des porcheries industrielles, lavages des minerais de charbon, etc.). Il
est plus simple d’avoir un seul adversaire bien désigné que
de s’attaquer aux causes véritables d’une pollution multiforme et
liée à des intérêts multiples.
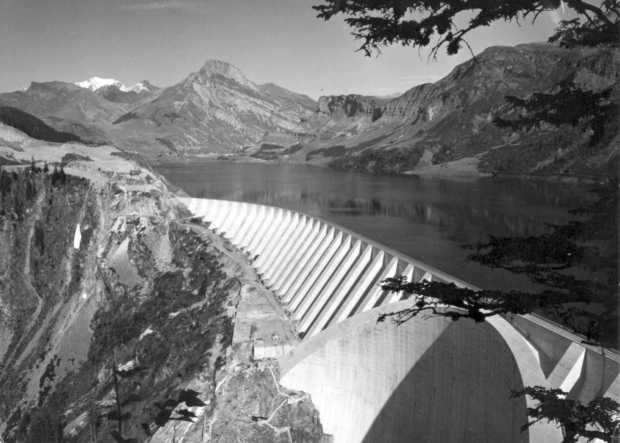
Les phénomènes «d’eutrophisation» (prolifération
des végétaux aquatiques provoquée par l’excès
de substances nutritives) ou les productions de méthane et de gaz
carbonique, dues à la décomposition des végétaux
et de la biomasse des forêts, sont plus difficiles à éviter,
dans la mesure où le déboisement complet des retenues avant
leur mise en eau n’est pas toujours possible. Cependant, à partir
de notre expérience directe, il semblerait que ces émissions
de gaz s’arrêteraient assez rapidement avec la disparition de la
biomasse elle-même. A Vouglans, deux années durant, une forte
odeur de soufre s’est dégagée avec la vidange des eaux verdâtres
du fond de la retenue. Mais depuis, ces eaux sont redevenues aussi limpides
que celles de la plupart des grands lacs de barrages de France.
Le grand réservoir de Petit Saut en Guyane, qui avait si mauvaise réputation, nous a aussi agréablement surpris il y a deux ans, quand nous l’avons entièrement traversé de l’aval vers l’amont. Un bain agréable et rafraîchissant dans une eau relativement limpide nous a alors fait un peu oublier la «pollution visuelle»constituée par la forêt d’arbres morts et décharnés.
Séismes et glissements de terrain :
On reproche aussi aux réservoirs de barrages de provoquer des
glissements de terrains et des séismes. Faut-il rappeler que ces
phénomènes naturels préexistent à la construction
des barrages ? Le plus souvent les mises en eau des barrages ne font qu’accélérer
un processus naturel en cours. Mais celui-ci n’a pu être décelé
que lors d’études géologiques et sismiques entreprises avant
la décision de réaliser ou non les travaux.
Signalons aussi que dans des régions classées comme non-sismiques,
le seul fait d’installer des sismographes avant la construction des barrages,
a permis d’enregistrer nombre de petits séismes qui passaient inaperçus,
comme à Roselend, et cela bien avant la mise en eau du barrage.
Il en était de même à Kariba (voûte de 130 m
de haut). Mais dans ce cas, avec sa retenue énorme de 160 milliards
de m3, les séismes se sont multipliés et ont cru d’intensité
avec la montée progressive du plan d’eau, jusqu’à une magnitude
de 6, à la fin du remplissage. On a même pu mesurer par nivellements
topographiques des tassements significatifs des rives de la retenue et
du barrage lui-même.
La plupart du temps, les séismes résultent d’une libération
brutale des fortes contraintes accumulées par la tectonique des
plaques continentales. Est-ce alors négatif si les grands ou
les petits réservoirs, en injectant de l’eau, même en faible
quantité dans des failles profondes contribuent à les lubrifier
et à faciliter leur relâchement, suivant le principe du «tonneau
de Pascal».
Un séisme de forte intensité, pourrait alors se transformer
en multiples petites secousses réparties dans le temps et beaucoup
moins destructrices… C’est du moins l’une des hypothèses de travail
que nous avons pu envisager lors de la mise en eau du barrage de Vouglans
(600 millions de m3 de retenue), et du petit séisme qu’il aurait
provoqué dans une faille traversant la retenue.

Du côté des glissements de terrain, la terrible catastrophe
de LONGARONE a été provoquée par la masse énorme
de 250 millions de m3 du Mont TOC qui a dévalé dans la retenue
de 170 millions de m3 du barrage de VAIONT, avec une vitesse accélérée
par la formation d’un coussin de vapeur d’eau sur la surface de glissement.
Depuis, les études de stabilité des pentes des futures retenues
sont beaucoup plus précises et complètes.
De même, après la rupture du barrage de MALPASSET, les
études de la stabilité et de la résistance des appuis
rocheux des barrages voûtes sont aussi soignées que pour le
barrage lui-même.
Ces deux exemples et bien d’autres, comme la rupture des deux petits barrages (SHEFFIELD et SAN FERNANDO) chevauchant la faille de SAN ANDREAS (Californie) confirment l’importance primordiale des études géologiques et géotechniques qui doivent précéder de longue date l’implantation et les études des barrages eux-mêmes. C’est ainsi que l’on pourra décider à temps si les risques à prendre sont acceptables ou non.
Sédimentation des retenues :
Les services rendus par le grand barrage d’ASSOUAN tout comme ses inconvénients
sont bien connus. Sans cet ouvrage, l’Egypte connaîtrait probablement
à l’heure actuelle des famines endémiques à chaque
année sèche…
Pendant des milliers d’années, la crue annuelle du Nil (d’août à octobre) a fertilisé les terres arables de ses rives et du delta dont la surface s’accroissait régulièrement. Depuis le fonctionnement normal de ce barrage à partir de 1965, le Nil cessa de déposer sa couche brune de sédiments. Et aujourd’hui, quelque 30 % (chiffre à vérifier) de l’électricité produite par ce barrage serait utilisée par des usines d’engrais chimiques, désormais nécessaires pour compenser l’absence de dépôts de limons. En même temps, les rivages du delta érodés par la mer sont en train de reculer de façon inquiétante.
On aurait pu espérer que ces deux importantes expériences
auraient profité aux grands projets suivants. En particulier, dès
1973, nous avions proposé nos services pour les études du
Grand Barrage de HOA-BINH (Viêt-nam) pour entre autres objectifs,
essayer d’éviter les déboires précédents.
Lors de ma visite en Octobre 1989 sur le chantier, je constatais que
tout comme à ASSOUAN, les grandes galeries des dérivations
provisoires avaient été obstruées avec des bouchons
de bétons, et qu’aucune vidange de fond n’avait été
prévue.
Quant aux projets des grands barrages chinois auxquels nous avons participé,
nous avons toujours préconisé de turbiner les boues au fur
et à mesure de leur arrivée dans les retenues, et avant leur
consolidation. Si nécessaire des turbines spéciales auraient
été alimentées directement par les eaux de fond plus
boueuses, transitant par les anciennes galeries de dérivation provisoires
équipées en conséquence, et qui ont l’avantage d’aller
récupérer les sédiments plus à l’amont que
les prises d’eau classique et au fond de la retenue .
Ces propositions faites depuis 1979 et après discussions, en accord avec les spécialistes de NEYRPIC, avaient alors reçu un accueil très favorable des différents «Design Institute» chinois.
Mais toutes ces propositions sont malheureusement bloquées car
les finances sont drainées par le projet pharaonique des Trois Gorges.
Espérons du moins que ce dernier tiendra compte des expériences
passées, pour turbiner en permanence une partie des quelques 10
milliards de m3 de sédiments sableux qui vont atterrir dans sa retenue
dans les 80 ans à venir.
L’usine de barrage de Serre-Ponçon, avec ses conduites forcées
raccordées aux galeries de dérivations provisoires transformées
en vidanges de fond, fonctionne sans gros problèmes depuis près
de 40 ans.
Dégâts culturels et humains :
Le sauvetage exemplaire des temples d’ABOU SIMBEL de la submersion
par les eaux du barrage d’ASSOUAN est encore dans toutes les mémoires,
grâce à leur caractère spectaculaire… Mais cet exploit
fait oublier les nombreuses richesses culturelles et historiques englouties
par les grands barrages turcs ou iraniens. Dans quelques années,
à partir de 2006, des villes entières de la vallée
du YANG TSE et leurs patrimoines irremplaçables seront submergés
par la mise en eau des Trois Gorges.
Mais, pour nous, les dégâts humains sont autrement plus
graves…surtout quand on les compare avec ce que nous avons connu en France.
En Turquie ce sont 30 000 personnes déplacées par le
barrage de KEBAN, 50 000 à KARIBA sur le Zambèze, 70 000
personnes à TSIMLIANSKAYA sur le DON en Russie, 90 000 personnes
à AKOSSOMBO sur la Volta au Ghana, et surtout le drame humain des
1 200 000 personnes déplacées par les TROIS GORGES. Ce seul
chiffre aurait dû condamner irrémédiablement ce projet.
Mais les travaux sont maintenant irréversibles. Il vaut mieux essayer
aujourd’hui d’aider les populations déplacées à améliorer
leur sort et veiller à ce que les promesses officielles soient au
moins respectées.
Enfin, le record semblerait être détenu par l’Inde, dont
le chiffre officieux serait de 40 millions de personnes déplacées
par les barrages depuis 50 ans… sans compter les menaces qui pèsent
sur les 25 millions d’habitants vivant dans la vallée du NARMADA,
avec les projets de 30 grands barrages et 135 de taille moyenne sur 3 200
au total.
Signalons, cependant, qu’en Chine, et d’après nos collègues
du «Design Institute» de XIAN, responsables du projet du grand
barrage de LAXIWA sur le fleuve Jaune, le nombre de familles vivant dans
l’emprise de la future retenue aurait pratiquement doublé, et cela
malgré l’interdiction officielle de nouvelles implantations. Il
semblerait que les indemnités promises et l’espoir d’un meilleur
niveau de vie aurait motivé cet afflux plus ou moins clandestin.
Sur le chantier du barrage de YELE, dans les montagnes du SICHUAN,
les ingénieurs et ouvriers du chantier vivaient dans des cabanes
très sommaires semblables à celles des villageois du pays.
Une nouvelle route d’accès d’excellente qualité et l’arrivée
de l’électricité qui sera produite avec des mini-centrales
hydrauliques in situ permettra le relogement des villageois installés
actuellement dans la cuvette du futur barrage, dans de bien meilleures
conditions et sur les pentes douces et verdoyantes avec cultures en terrasse.
Ces deux derniers ouvrages que nous avons visités sont probablement assez exceptionnels par les possibilités d’échanges ou d’extensions des surfaces cultivables…alors que dans bien des régions, les cuvettes sont souvent les seuls lieux possibles de cultures et de pâtures, et les pentes sont trop abruptes pour être facilement aménageables.
Pour une écologie au service de l’Homme
:
Nous savons combien il est important que l’Homme et la Nature vivent
en symbiose et harmonie pour que les générations futures
ne puissent nous reprocher d’avoir saccagé une Terre unique et irremplaçable.
Mais faut-il encore que les critères d’une saine écologie
ne se transforment pas en dogmes sectaires.
Ainsi lorsque certains se félicitent comme «d’une grande
victoire de la démolition aux Etats-Unis de plus de 120 barrages
importants durant ces vingt années, après des batailles en
règle», on peut mesurer l’ampleur du fossé qui nous
sépare.
Il est certes important que saumons, esturgeons et bars rayés
puissent remonter fleuves et rivières, et nous comprenons tout à
fait les oppositions qui peuvent se manifester contre la construction de
nouveaux barrages… Mais quel gaspillage que la suppression d’un patrimoine
qui durant 30 à 50 ans a permis aux populations de toute une vallée
de vivre et de se développer !
Des pays gâtés par la nature et enrichis par le travail
de ses habitants, mais aussi par l’exploitation des ressources des autres
pays moins développés, peuvent peut-être se le permettre.
Mais un tel gâchis serait inadmissible et scandaleux dans un pays
des Tiers-Mondes.
En tant qu’Hydrauliciens, notre vie durant, nous avons travaillé pour essayer de soulager la peine des hommes et surtout des femmes pour leur éviter, par exemple, ces épuisantes «corvées d’eau» qui mangent une bonne partie de leur temps et de leur énergie. Nous pensons qu’un combat de longue haleine contre la misère et l’injustice est la priorité la plus urgente, sans négliger «petites fleurs, petits oiseaux et gros poissons»… Mais la vie est faite de choix et pour nous, l’écologie doit d’abord être au service des Hommes et de leur avenir… et non l’inverse.
L’Hydraulique, service public :
En mai 1999, sous l’égide de la banque mondiale et de l’Union
mondiale pour la Nature, a été créée la «
Commission mondiale sur les barrages », organisme indépendant.
Sa mission est d’éclairer la société civile et,
en deux ans, de faire le point sur le rôle des grands barrages dans
le développement économique et trouver si possible un large
consensus pour de nouveaux critères pour leur conception, leur exploitation
et éventuellement leur déclassement.
Nous ne pouvons que souhaiter efficacité et succès à
cette commission… Mais la déclaration de son secrétaire général
ACHIM STEINER, dans «The Economist» (26/11/99) est quelque
peu préoccupante : «Même les plus zélés
des bâtisseurs de barrages de l’Asie sont maintenant plongés
dans les principes de la mondialisation par les forces du marché».
Et les commentaires de ce journal : «car ils doivent faire face aux
restrictions des investissements privés comme publics. Les inévitables
protestations augmentent les risques financiers, et donc les coûts.
Un autre facteur est la dérégulation continue de l’industrie
mondiale de l’énergie qui tend à transférer les financements
vers les secteurs privés, et vers les projets à moindre risque
et à retour rapide des sommes investies : ce qui signifie l’élimination
des grands barrages et la préférence accordée aux
centrales thermiques à gaz».
Cette citation nous confirme pour notre part, que les grands barrages,
investissements d’intérêt général à long
terme, ne peuvent être pris en charge que «comme service public»,
par une puissance publique garante de l‘intérêt général.
Quant à savoir s’il n’est pas préférable de construire
des petits barrages en plus grand nombre à la place des grands,
c’est un débat aussi amorcé à HSF, et qu’il serait
intéressant de reporter à l’un des prochains numéros
d’H2O.