 EDITORIAL
EDITORIAL
De la passion de notre métier à une action
collective de solidarité
La passion de notre métier au service de l’homme
Chacun connaît l’histoire de ce grand chantier de construction
où à la question : «Qu’est-ce que vous êtes en
train de faire?» trois ouvriers répondirent, le premier :
«je casse des cailloux» ; le second : « je gagne ma vie»
; le troisième : «je construis une cathédrale».
Cette anecdote reste d’actualité. L’évocation par Pascal
Marin du travail de son père Gilbert a profondément ému
les anciens qui ont connu l’épopée des chantiers de grands
barrages, : « un solide travail d’ingénieur, dans la tradition
humaniste d’une technique qui ne soit pas commandée par la seule
puissance de l’argent mais s’intègre à la perspective d’un
projet, avec tout son poids d’humanité».
Ce message vécu dans notre vie professionnelle a toujours été
présent dans notre Association technique pour le développement
et se traduit au quotidien par une constante volonté de valoriser
le travail manuel, moyen d’échange à équitable avec
nos partenaires villageois. Nous mettons aussi toute notre intelligence
et nos compétences au service du projet qui nous a été
confié par ces mêmes partenaires, tout en sachant que nous
avons autant à recevoir qu’à partager, depuis la conception
jusqu’à la réalisation.
Une action collective de solidarité
Tout aussi important, un deuxième message complète le
précédent : une personne , quelle que soit sa valeur individuelle,
doit s’appuyer sur un véritable travail d’équipe et intégrer
son action dans un projet collectif de solidarité.
Ainsi, nous saluons la naissance et la multiplication dans de nombreuses
grandes entreprises de clubs humanitaires et de développement, à
l’initiative du personnel et encouragés par les Directions. Ils
améliorent à la fois l’image de marque de leur entreprise
et la motivation des volontaires, même dans leur travail professionnel.
Tout le monde est ainsi gagnant.
Toutes ces initiatives contribuent à sensibiliser le milieu
de travail et le monde industriel et, comme la traditionnelle B.A. (bonne
action) scoute, elles peuvent avoir un rôle pédagogique incontestable,
lancer une action de développement durable, c’est-à-dire
plus efficace à long terme en s’attaquant aux causes profondes du
sous-développement et non seulement à ses résultats.
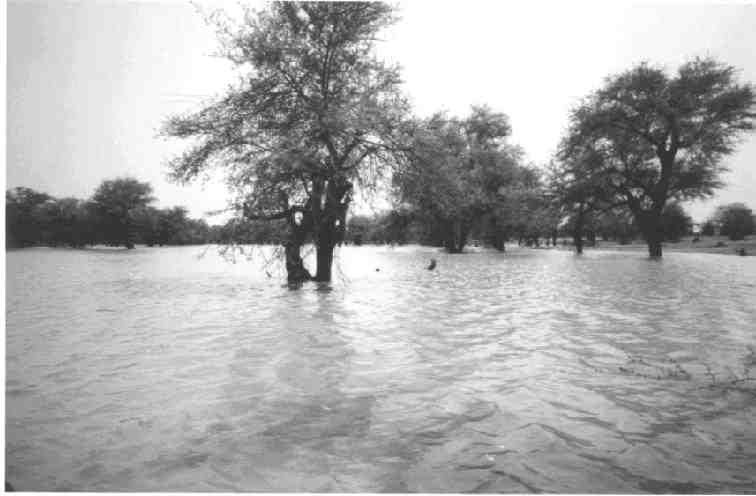
Cela suppose cependant quelques conditions minimales de cohérence
dans la politique de l’entreprise : que la main gauche humanitaire ne ferme
pas les yeux sur une main droite qui exploiterait la misère. C’est
bien qu’EDF “sponsorise” des projets d’aide au Tiers-monde, mais c’est
encore mieux qu’elle ne coupe plus le courant aux familles incapables de
payer leurs factures. Nous nous réjouissons que les volontaires
de la Lyonnaise ou de Vivendi puissent voler au secours des populations
pour leur apporter le minimum d’eau potable à chaque catastrophe
humanitaire, qu’elles soient le fait des hommes comme au Rwanda, ou de
la nature comme en Amérique centrale. Espérons que cette
solidarité dans l’urgence arrive à se prolonger «en
temps normal» dans les grandes cités du Tiers-monde par des
contrats de fourniture d’eau accessibles aux populations les plus défavorisées.
De même, les syndicats devraient être des lieux privilégiés
d’une action collective de solidarité. La notion de service public
doit être défendue en tenant compte non seulement de la situation
privilégiée des agents statutaires mais aussi de celle des
autres salariés qui travaillent à leur côté
et sont souvent infiniment moins bien lotis ou encore de la situation des
chômeurs. Il arrive que le respect d’un statut prétendu immuable
empêche l’embauche des jeunes.
Face à cet égoïsme catégoriel et corporatiste,
caricature du syndicalisme, pourquoi s’étonner que beaucoup de jeunes
se détournent de l’action collective et essayent de «tirer
leur épingle du jeu» à titre individuel.
Ainsi, notre monde n’est pas toujours aussi simple et manichéen
: d’un côté, les affreux capitalistes exploiteurs, et de l’autre,
les bons et vaillants travailleurs dont la plupart, du moins en France,
ne sont plus des «prolos».
Le champ d’une solidarité active est immense. HSF espère
que son action, la formation de nombreux jeunes ingénieurs et techniciens
en compagnonnage avec des anciens, contribue à rendre un peu plus
citoyennes et solidaires nos entreprises et bureaux d’études, nos
syndicats comme nos Associations.
