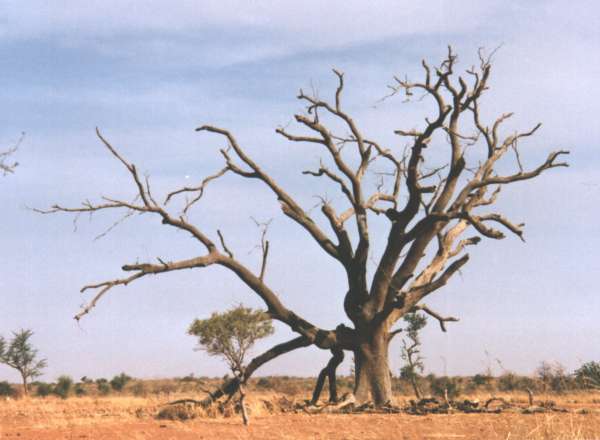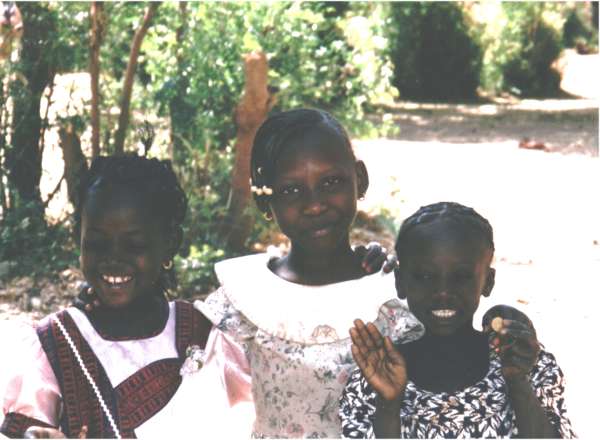Wompou. Août 1998. Du côté des sociologues.
En premier lieu, il s’agissait de définir les facteurs de
pérennisation du projet d’aménagement du lac. Pour cela,
je devais identifier les paramètres politiques, économiques
et sociaux pouvant contribuer à la réussite du projet — ou
à son échec — : la situation et les activités économiques,
la structure sociale traditionnelle déterminant la répartition
des richesses et notamment des terres, les compétences disponibles
sur place, la volonté des habitants de s’impliquer dans un projet
à long terme, les institutions politiques existantes, la capacité
de la population à assurer la gestion des ressources pour le bien
de la collectivité.
En second lieu, la mission avait pour tâche de permettre aux
villageois et à l’association des travailleurs de Wompou en France
de constituer les dossiers pour la recherche des financements. Il fallait
donc tenir compte des contraintes et des principes auxquels les bailleurs
de fonds sont sensibles : la protection de l’environnement, l’amélioration
des conditions de vie, en particulier, des groupes sociaux les plus vulnérables
comme les femmes et les enfants, la capacité à l’autogestion
et à la gouvernance locale.
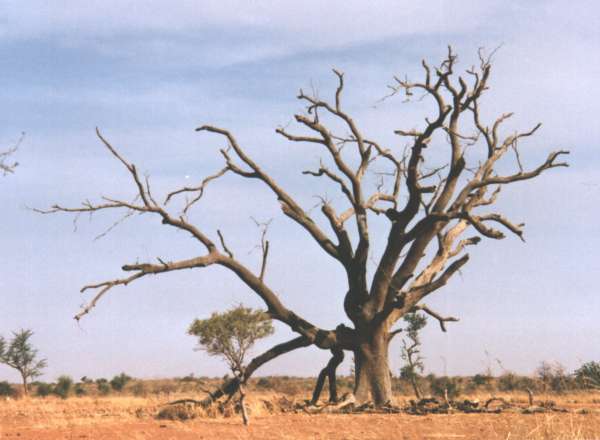 |
J'ai donc consacré ma mission à trois tâches
complémentaires :
la rencontre avec les représentants des différents
pouvoirs — traditionnel, territorial et représentant de l’État
central —,
les rencontres informelles avec les habitants du village et
les entretiens avec un certain nombre d’entre eux dont la place dans
le tissu social ou les activités sont apparues pertinentes pour
le projet. |
Le présent article s’attache à exposer trois éléments
déterminants dans le contexte socio-économique : l’organisation
traditionnelle de la société, la gestion et l’exploitation
des terres et les institutions collectives.
Anthropologie de la société de Wompou.
Mes travaux ont eu pour objectif de comprendre l’organisation sociale,
politique et foncière — les trois dimensions sont intimement liées
— de la communauté Soninké, l’ethnie dominante à
Wompou1.
La société Soninké est une société
segmentaire2 construite sur un ancien ordre de castes3. Elle est patrilinéaire,
ce qui signifie que l’organisation sociale, les modes de filiation et de
transmission du patrimoine sont régis par la seule paternité.
Elle est patriarcale et patrilocale, fondée sur le pouvoir exclusif
du doyen autour duquel la famille se regroupe.
La spécificité de la structure familiale soninké
réside donc dans le fait que plusieurs ménages consanguins
vivent ensemble au sein de la concession familiale, travaillent les mêmes
champs et partagent les repas. Tout est centralisé entre les mains
du chef de famille qui décide des récoltes comme des mariages.
Le village de Wompou rassemble plusieurs lignages mais il est dirigé
par un chef issu du lignage fondateur, la famille des Soumaré. Ses
membres détiennent des droits politiques et fonciers étendus.
C’est le doyen de la famille, Autoum Soumaré, qui exerce la fonction
de chef de village.
Organisation et répartition des terres.
Wompou, à l’instar d’autres villages de la zone dispose d’un
terroir qui comprend des terres wallo — culture de décrue
— des terres dieri — culture sous pluie —, ainsi qu’un espace agro-pastoral
et trois périmètres irrigués villageois4. À
cela, il convient d’ajouter les jardins de décrue situés
dans l’emprise du lac, qui ont été " colonisés " par
les femmes pour la culture des arachides et le maraîchage.
Le dieri et le wallo constituent la base de la répartition
traditionnelle des terres.
Le wallo est formé par l’ensemble des terres inondables.
Le wallo de Wompou est situé sur les rives du Sénégal,
sur une bande qui ne dépasse pas 2 km de largeur, et aux abords
immédiats de la mare. Cependant, l’aménagement du fleuve
en amont, la sécheresse et l’ensablement de la mare ont largement
contribué à l’abandon de la culture de wallo qui ne
bénéficient plus de la générosité des
crues. Nombre de terres wallo sont à présent cultivées
sous pluie.
Le falo est constitué par les terres situées
sur la berge du fleuve ou des marigots. Régulièrement inondé,
mais d’une superficie restreinte, il constitue la partie la plus attractive
économiquement et reste le domaine réservé des chefs
traditionnels qui cultivent généralement le maïs et
le maraîchage.
Le hollalde ranere représente les superficies les plus
larges du wallo en bordure de la mare et du fleuve, où les
hommes pratiquent la culture du mil et du sorgho. C’est sur ces terres
que sont établis les collade — sing. collengal —.
Le collengal est le terroir qui appartient à la famille étendue
et qui est exploité en commun. Il fait l’objet de règles
très strictes d’appropriation et d’utilisation et a été
réparti, à l’origine, entre les familles les plus influentes
du village. Il est en indivision, ne peut être vendu ou échangé
sans l’accord de l’ensemble des membres de la famille.
Néanmoins, le chef de famille règle les conflits fonciers
et fixe la date de démarrage des récoltes sur le terroir
familial. C’est lui qui, en début de campagne, décide de
la répartition des terres. Ainsi, dans la mesure du possible, il
assure des terres à chacun des membres de la famille.
Le dieri correspond à l’ensemble des terres hautes
non inondables, il est donc cultivé sous pluie. Il représente
l’essentiel des surfaces cultivables de Wompou. En raison de son abondance
et de sa faible valeur agronomique, son utilisation est soumise à
des règles souples d’appropriation. En général, qui
veut exploiter une parcelle libre peut le faire sans autorisation préalable
et sans considération pour son appartenance ethnique ou sociale.
Les terres dieri servent de réserve en cas de besoin exceptionnel.
La réhabilitétion du lac soulèvera un certain
nombre de problèmes en matière de répartition et de
gestion des terres.
En premier lieu, il sera nécessaire d’étudier le meilleur
moyen de gérer l’eau dans la perspective d’un système d’irrigation
se substituant aux méthodes utilisées actuellement.
En outre, les travaux de réhabilitation auront pour conséquence
la disparition des jardins installés par les femmes dans le lit
de la mare. Nous avons attiré l’attention des notables du village
sur la nécessité de réfléchir au moyen de remplacer
cette perte. Une solution est indispensable car le maraîchage permet
un apport alimentaire complémentaire, voire un revenu d’appoint.
Le troisième volet de notre enquête a été
l’identification des institutions collectives sur lesquelles il sera possible
de fonder la pérennisation du projet.
Les institutions collectives de Wompou.
Le village de Wompou dispose d’organisations communales que nous
pouvons répartir entre le milieu associatif et le milieu polico-administratif.
Le milieu associatif regroupe la coopérative des hommes, celle
des femmes, les organisations de la jeunesse, et à l’extérieur,
l’association des travailleurs de Wompou en France. Le milieu polico-administratif
est essentiellement structuré par le fonctionnement du pouvoir traditionnel,
de l’administration municipale et des " services publics " dont fait partie
la gestion de l’eau potable.
J’ai retenu trois exemples qui me semblent les plus pertinents et
qui concernent les femmes et les jeunes. Les femmes interviennent à
un double titre dans le cadre de la coopérative et dans la gestion
de l’eau potable. Les jeunes, regroupés dans deux associations,
organisent différentes actions dans le domaine de l’assainissement,
de la santé et de l’agriculture.
L’association des femmes
La coopérative des femmes a été créée
en 1987 et regroupe actuellement 429 femmes mariées.
Leur principale activité est le maraîchage qu’elles
pratiquent sur deux terrains : un jardin près de la mare exploité
en culture de décrue et un périmètre irrigué
équipé d’une moto-pompe, situé près du fleuve.
Les terrains sont divisés en 2 parties. Une parcelle est réservée
au travail collectif dont les produits sont destinés à la
vente au profit de la coopérative. L’autre partie a été
divisée entre les femmes qui exploitent leur parcelle pour leur
propre compte.
La seconde activité de la coopérative est liée
à un programme récent de l’UNICEF de développement
de la santé communautaire et de lutte contre le paludisme. Dans
le cadre de ce programme, l’idée est de responsabiliser les communautés
rurales dans la prise en charge de la santé et de l’hygiène
grâce à la mise en oeuvre de campagne de sensibilisation et
de formation, auxquelles sont associés les femmes et les jeunes
en priorité.
Les femmes de Wompou ont la tâche d’imprégner les moustiquaires
et de les vendre. Pour cela, elles perçoivent 20 % du prix de l’imprégnation
fixé à 150 UM5.
Au cours de nos rencontres, les femmes ont exprimé leur volonté
de donner un nouveau souffle à la coopérative. Elles souhaitent
développer d’autres ateliers lucratifs, tels que la couture ou la
teinture des tissus.
Une autre tâche qui incombe aux femmes de Wompou est l’approvisionnement
et la gestion de l’eau potable.
L’approvisionnement du village est principalement assuré par
trois bornes-fontaines alimentées par un forage à l’énergie
solaire.
Avant le 1er juillet 1998, la tarification était forfaitaire.
Chaque foyer payait une redevance mensuelle de 150 UM pour faire face aux
différents frais. En outre, les femmes étaient astreintes
à une discipline. Elles ne pouvaient puiser de l’eau que par des
seaux ou des bassines. Un fontainier orchestrait l’ouverture et la fermeture
des robinets entre 6 heures et 20 heures, tous les jours.
Le système a été modifié après
la mission d’Olivier Le Masson, du GRET, qui nous a précédées
de quelques semaines. Le paiement forfaitaire encourageait le gaspillage
et favorisait les mauvais payeurs.
Depuis lors, l’eau est payée au volume. Les trois femmes attachées
aux bornes perçoivent 2,5 UM par bassine de 30 litres, dans la limite
de deux bassines par passage.
En outre, les " fontainières " doivent veiller à ce
que tout se passe en bonne intelligence et régler les conflits éventuels.
Néanmoins, le maire et la police sont obligés d’intervenir
lorsque les discussions dégénèrent. Ces emplois sont
rémunérés par un salaire mensuel fixe de 3000 UM plus
10 % des recettes.
Enconséquence de quoi, les femmes nous apparaissent particulièrement
bien placées pour prendre une part active à des projets liés
au développement de la mare. Cette participation peut se situer
dans le cadre de leurs activités collectives et domestiques. Néanmoins,
il semble nécessaire de développer les compétences
en matière d’hygiène, d’assainissement et de gestion pour
plus d’efficacité et d’autonomie.
Les associations de jeunes
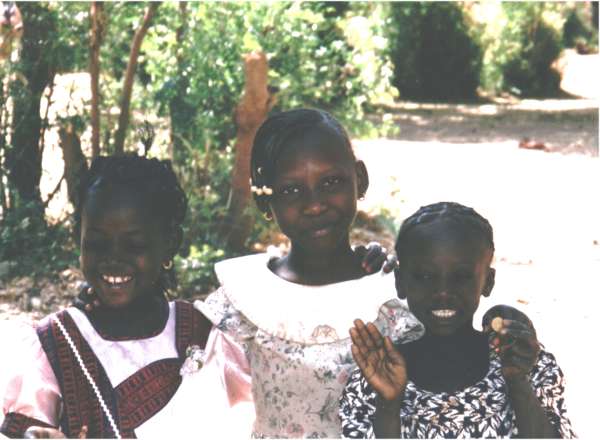 |
La jeunesse constitue également un élément
important de la population de Wompou.
Il faut distinguer deux groupes principaux. |
Les jeunes qui résident en permanence à Wompou constituent
la population la plus vulnérable. La plupart n’ont pas poursuivi
d’études au-delà de l’école primaire et sont directement
touchés par la situation économique et sociale du village.
Ils représentent le principal creuset de l’immigration précaire
vers Nouakchott, à défaut de pouvoir s’expatrier en France.
Le second groupe est celui des écoliers et des lycéens
qui sont scolarisés ou étudiants à Nouakchott. Ils
reviennent à Wompou pour les vacances scolaires et participent aux
activités villageoises.
Il existe en fait deux associations (83 garçons et une cinquantaine
de filles), représentées au sein de l’association de la jeunesse
de Wompou, à laquelle est intégrée l’association des
écoliers.
En dehors de l’organisation de soirées durant l’été
et d’un tournoi de foot, les deux associations ont plusieurs missions et
activités sur lesquelles pourraient s’appuyer des initiatives liées
à la réhabilitation du lac
Tout d’abord, l’association des écoliers met en place, durant
les vacances estivales, des ateliers d’alphabétisation pour les
plus défavorisés.
Ensuite, dans le cadre du programme de santé communautaire
de l’UNICEF, ils proposent des séances de sensibilisation et d’information
sur la santé et l’hygiène. Cette année, ces séances
devaient prendre la forme de pièces de théâtre. Dans
le même cadre, ils organisent, tous les lundis, des travaux d’assainissement
durant lesquels ils tentent de nettoyer les voies publiques et les abords
du village. Mais leur action est un véritable supplice de Sisyphe
car ils rencontrent des difficultés à faire reconnaître
l’utilité de leur travail au reste de la population.
Enfin, l’association des jeunes dispose d’un périmètre
qu’ils travaillent en maraîchage durant la saison sèche.
Les conclusions de mes travaux ne laissent aucun doute quant à
la nécessité d’aménager le lac de Wompou. Les témoignages
que j’ai recueillis accréditent le fait qu’il a longtemps été
une des bases de l’activité économique et sociale, en fertilisant
les terres, en abreuvant le bétail, en fournissant l’eau pour les
activités domestiques et en abritant un écosystème
favorable à la pêche et à l’équilibre de l’environnement.
Mes enquêtes ont également montré la dimension
que doit prendre le projet si nous — le " nous " inclut HSF, l’Association
des travailleurs de Wompou en France et surtout la population — voulons
que l’ensemble de la population en bénéficie.
D’un point de vue économique, la réhabilitation du
lac devra contribuer à la remise en valeur des terres et au retour
de la faune aquatique, mais en tenant compte des équilibres écologiques.
Autrement dit, il faudra prendre en compte la protection des ressources
naturelles en définissant les meilleurs usages pour éviter
leur dégradation et leur gaspillage. En outre, le couvert végétal
qui protégeait le lac et le village contre l’érosion et l’avancement
du désert devra être reconstitué.
D’un point de vue social, il est essentiel de construire un mode
de communication et d’échange entre les forces vives de Wompou.
En effet, pour une société ethniquement homogène,
il subsiste une absence quasi totale de dialogue entre les différents
groupes et les institutions due essentiellement aux contraintes établies
par les traditions, telles que les barrières entre les générations
fondées sur la structure patriarcale7.
J’insiste donc sur la nécessité d’établir une
approche intégrée — qui englobe tous les facteurs sociaux,
politiques et économiques — et tenant compte de l’ensemble des acteurs
concernés dans une même perspective pour la pérennisation
de la réhabilitation du lac.
Annabelle BOUTET
1 Quatre groupes ethniques constituent
le tissu social de Wompou. les Soninké, les Peuls,
les Maures noirs et les Maures blancs.
2 Elle repose sur une structure lignagère.
La lignée correspond à un groupe de parentés pouvant
retrouver généalogiquement sans interruption un ancêtre
commun, selon un système de filiation donné.
3 L’ancien système divisait
la société en 3 castes : les nobles, les marabouts, les esclaves
auxquelles il faut adjoindre le groupe séparé des griots.
4 Un seul périmètre est
utilisé et géré par la coopérative des hommes.
Il est équipé de deux moto-pompes qui captent l’eau directement
du fleuve Sénégal. Un deuxième périmètre
a été planté d’arbres fruitiers par l’un des ressortissants,
Omar Soumaré. Le dernier périmètre est à l’abandon.
5 1 franc = 35 ouguiyas mauritaniens.
6 Les hommes et les femmes sont considérés
" jeunes " aussi longtemps qu’ils sont célibataires. Cette répartition
régit leur intégration dans les différentes institutions
villageoises et pour les hommes leur droit à la parole dans le conseil
du village.
7 Je ne parle même pas des représentants
du pouvoir central et des autres communautés ethniques exclus, sauf
quelques rares exceptions, du tissu social.